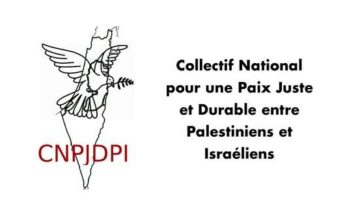par Florent Gougou, maître de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble et chercheur au laboratoire de science sociale Pacte et Simon Persico, professeur de science politique à Science Po Grenoble, chercheur au laboratoire de science sociale Pacte.
Lors de sa démission surprise à la fin de l’été 2018, Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, insiste sur une impossibilité : celle de mener des politiques publiques à la hauteur de la crise écologique dans un gouvernement visant surtout le développement économique. Son propos est sans appel : « On recherche une croissance à tous crins (…). Quand on se réjouit de voir sortir de Saint-Nazaire un porte-conteneurs qui va porter 50 000 conteneurs. Superbe performance technologique… Est-ce bon pour la planète ? La réponse est non. »
Nicolas Hulot reprend ici à son compte l’argument central de la doctrine écologiste : limiter la croissance pour mieux préserver la planète. Que pensent les Français de ce dilemme entre protection de l’environnement et croissance économique ? Une majorité (50 %) privilégie la protection de l’environnement au détriment de l’économie et de l’emploi. Seulement un tiers choisit l’économie.
Cette préférence pour l’environnement est-elle partagée de la même manière dans toutes les couches de la société ? Pas tout à fait. Depuis les travaux de Ronald Inglehart sur le développement des valeurs dites « postmatérialistes », la protection de l’environnement est présentée comme une priorité des personnes les plus dotées en ressources culturelles et économiques. Défendre la planète serait le luxe de celles et ceux qui n’ont pas à se préoccuper de leurs conditions matérielles d’existence.
De fait, c’est bien parmi les Français les plus diplômés et aux revenus les plus élevés que la défense de l’environnement atteint son maximum (respectivement 70 % et 60 %). Elle est cependant prioritaire aussi pour l’ensemble des niveaux de diplôme et de revenu, à l’exception des niveaux d’instruction primaire (39 % contre 44 % pour la croissance économique).
« La priorité à la protection de l’environnement atteint son maximum avec la génération 1970-1979 »
L’impact du renouvellement des générations est indéniable. La montée des préoccupations environnementales a été portée par l’arrivée de nouvelles cohortes. Minoritaire dans la cohorte 1930-1939, la priorité à la protection de l’environnement devient majoritaire au sein de celles socialisées dans l’après-guerre. Elle atteint son maximum avec la génération 1970-1979, avant de reculer légèrement avec les plus jeunes. L’avenir nous dira si les préoccupations environnementales ont connu un pic avec la cohorte 1970-1979. Ou si, au contraire, le renouveau des mobilisations, dans les universités et les lycées notamment, viendra donner un second souffle à cette transformation des valeurs.
Du côté des préférences politiques, la priorité à l’environnement est plutôt le fait des Français très intéressés par la politique (67 %) et qui partagent les valeurs couramment associées au postmatérialisme, notamment le libéralisme des mœurs et l’anti-autoritarisme. L’écart selon l’orientation politique est sans doute le résultat le plus important pour l’avenir de l’écologie. Les personnes de gauche soutiennent beaucoup plus la protection de l’environnement, tandis que les individus orientés à droite privilégient très fortement la croissance et la création d’emplois.
Loin des discours convenus, la protection de l’environnement n’est donc pas une option consensuelle au sein de la population française quand elle est présentée comme incompatible avec le développement économique. La polarisation croissante du débat public sur la crise environnementale, qui voit les citoyens les plus sensibles à cette question s’inscrire de manière croissante dans l’espace des valeurs – et des partis – de gauche, réserve sans doute encore des surprises quant à l’évolution des préférences écologistes.